
Il convient de bien situer l’étude de ce texte de Bergson par rapport à la critique de la passion (et donc du romantisme) par Ferdinand Alquié. Le philosophe définit la passion comme un refus du temps, mais de quel temps? Celui que nous divisons non seulement en passé, présent, futur, mais aussi en minutes, heures, secondes. Dire que le temps est divisible, c’est exactement faire la même chose que Zénon d’Elée qui confondait le mouvement de la flèche avec l’espace qu’elle a parcouru. Or aucune flèche ne peut traverser un certain espace donné sans le faire (en une seule fois) dans un temps donné. Mais que fait on pour mesurer ce temps? On le chronomètre, c’est-à-dire qu’on délimite sur un cadran le nombre d’unités nécessaires à la flèche en cliquant sur le top départ, et en recliquant quand la flèche arrive à son but. Nous n’avons plus qu’à lire le chiffre indiqué par l’aiguille sur le cadran: tout est visible, situé, ciblé, spatialement décompté….Et complètement faux. Pourquoi? Parce que nous rendons compte d’un mouvement UN, continu, indivisible par une accumulation d’unités régulières qui, comme des grains de sable, se seraient accumulés en se distinguant les unes des autres dans un sablier. Peut-être ne pouvons-nous mesurer cette durée qu’en la visualisant, qu’en la traduisant en ces unités comptables, accumulantes, distinctes les unes des autres, cela n’empêche pas que ce qui a rendu possible que la flèche franchisse l’espace de A à B en une seule fois, en un seul mouvement, c’est que précisément quelque chose d’elle n’a pas fait qu’accumuler des unités décomposables, distinctes, extérieures les unes aux autres. L’homme ne peut comprendre un mouvement que par le biais d’un repère extérieur à ce mouvement, c’est ce qu’il fait pour tout et c’est ce que l’on appelle « objectivité ». Si je veux rendre compte d’une réalité, il ne faut surtout pas que je sois pris en elle. On ne réalise une chose qu’en s’en « distinguant », qu’en marquant un écart à l’égard de cette chose. Comprendre un mouvement, c’est tuer un mouvement, c’est le diviser lui qui n’est pas divisible, c’est le compter lui qui n’est pas comptable, c’est le visualiser lui qui n’est pas visualisable, c’est le spatialiser, lui qui n’est pas de l’espace. Et c’est une évidence puisqu’il est du temps.
L’une des subtilités de Bergson consiste précisément à distinguer cet écoulement (appelons le comme ça, faute de mieux) en Temps et en Durée. Le temps, c’est finalement la façon humaine, scientifique de se sortir de cette impossibilité: on fait des mesures, on divise le temps, on le spatialise et on pose qu’il n’est pas à la portée de l’homme de se rendre mieux compte de ce dynamisme là, de ce changement. C’est un peu ce qui se passe quand on voit ses cheveux blanchir et tomber: on voit les traces visibles d’un changement invisible et insensible (en ce sens qu’il faudrait vraiment une perception de soi accrue pour se sentir vieillir). Je vois aussi une aiguille trotter sur un cadran et je dis « le temps passe » alors qu’en fait ce qui se produit c’est une aiguille qui court, des chiffres qui change sur un cadran, mais en fait je ne comprends toujours rien de ce qui rend possible qu’il change aussi et finalement surtout au gré d’une autre dimension. que celle de l’espace. En effet que sur un cadran tel chiffre cède la place à un autre chiffre, ou, sur une montre, que l’aiguille passe d’une minute à une autre minute, implique, induit absolument (et pas relativement) que cette succession soit possible, que les choses n’en soient pas restées là en l’état. Or si nous n’étions que dans l’espace, rien ne changerait. C’est ça l’intuition la plus simple et la plus profonde du « devenir ».

Pour que les choses et les personnes puissent se mouvoir dans l’espace il faut qu’elles changent dans le temps. Nous croyons toutes et tous que nous sommes dans l’espace et que nous changeons en nous que nous vieillissons, comme si c’était deux mouvements distincts mais en réalité, c’est parce que nous vieillissons que nous bougeons dans l’espace. C’est au gré de ce devenir là que le mouvement dans l’espace peut s’effectuer que je peux me mouvoir d’une place à une autre. Comprenons nous enfin le fond de cette affaire là? Nous vieillissons, nous changeons, nous devenons et quoi que je fasse: bouger ou ne pas bouger dans l’espace, ce mouvement là se fait et rien ne peut se faire, s’effectuer qu’au gré de ce mouvement là, mouvement insensible, invisible, indétectable, indomptable, indécomposable, absolu et pas du tout relatif.
Nous sommes totalement conditionnés à penser que rien ne se produit ailleurs ni autrement que dans l’espace, que comme des mouvements dans l’espace alors qu’en réalité ce n’est parce qu’il y a de l’espace qu’il y a des mouvements mais parce qu’il y a du mouvement (et surtout du mouvement non spatial: c’est très important) qu’il y a des mouvements dans l’espace. Rien ne saurait se déployer autrement, rien ne saurait changer, ni advenir qu’au gré de ce déploiement invisible, irreprésentable, indétectable. Jamais nous ne sommes plus prés de saisir la vérité authentique de la durée que lorsque nous nous réalisons qu’une chose diffère sans que nous l’ayons vue différer et pourtant il ne fait aucun doute qu’elle a changé.
Il existe un mot qui se situe au coeur de cette intuition aussi juste que paradoxale de la durée, c’est le terme de « différence ». Il suppose qu’une chose est différente d’une autre. Si je me l’applique à moi-même, je dirai que je suis différent aujourd’hui de celui que j’étais hier, comme si j’étais devenu autre, comme si je ne pouvais rendre compte de cette transformation qu’en disant j’étais une personne dans l’espace et je suis devenue une autre personne dans l’espace. En vérité, je ne suis pas quelqu’un de différent, je suis quelqu’un qui a différé, et c’est ça ma vie: « différer ». Nous ne nous différencions pas les uns des autres, nous différons sans cesse de nous-mêmes à nous mêmes. Nous différons au gré d’un seul et même devenir et cela s’appelle la durée.

C’est exactement dans cet esprit que le philosophe Jacques Derrida a inventé la notion de « différance », avec un a. Ce n’est pas une faute d’orthographe, et c’est aussi dans cet esprit que Gilles Deleuze parle des voyageuses et voyageurs immobiles. Si je veux vraiment réaliser de façon juste et absolue ce que c’est qu’être en présence d’un cube, par exemple, il va bien falloir à un moment donné que j’accède à cette dimension où, au-delà de tout ce qui nous distingue, lui et moi « durons ensemble », cela signifie que sa vitesse d’érosion et ma vitesse de vieillissement coïncident. Tout ce que je dirai avant d’arriver à cette conclusion sera vrai bien sûr mais « spatialement », c’est-à-dire relativement à ma position et à sa position dans l’espace: or que pourrais-je dire? Notamment que je ne le verrai jamais tel qu’il est sous tous ses angles, par toutes ces faces. Autrement dit la perception dans l’espace ne pourra jamais être que partielle, incomplète. La perception dans la durée, elle, sera exacte mais indicible, incompréhensible, incommunicable. Elle consisterait en un sens à dire que je ne fais qu’un avec le cube, pas du tout en ce sens que je me serais confondu avec lui mais plutôt en ceci que lui est moi nous serions perceptibles au fil d’une autre dimension où nous sommes des vitesses différentes au sein d’une seule et même durée. Nous ne faisons qu’un parce que la vérité c’est que rien de ce existe dans l’univers, dans la vie, n’est autre chose que « ça »: des coïncidences dans la durée.
Aucune image ne pourrait mieux rendre cette réalité là que celle d’un chœur vocal. Regardez le: vous voyez des personnes distinctes dans un espace puis fermez les yeux, vous entendez un son avec des tonalités multiples variées mais composant une seule et même unité phonique. Il faut envisager la possibilité que cette unité vocale soit antérieure, plus vraie, plus authentique que la vision ce qui revient tout simplement, finalement à hiérarchiser autrement nos sens: pour une fois, l’ouïe prévaudrait sur la vue. Dans le choeur ce qui serait fondamental, c’est que nous y ferions l’expérience d’une dimension première et authentique au sein de laquelle nous serions en mesure de faire se coïncider nos voix, le temps d’une chanson mais en même temps ce « temps » de la chanson contiendrait en lui une incroyable et insoupçonnable vérité: cela n’aurait pas été possible si la mélodie chantée ne l’avait pas été au gré d’un dynamisme qui est celui de la durée.

Dans le processus de réminiscence du goût de la madeleine tel qu’il est décrit par le narrateur du livre de Marcel Proust, quelque chose de cette durée, indiscutablement se révèle. Ce passage est d’une profondeur inouïe et ce qui s’y déploie est une expérience que nous avons toutes et tous déjà vécue: un parfum, une saveur, un lieu nous troublent et nous font réaliser, comme le dit Proust, « la rumeur des espaces traversés ». Il est crucial d’insister que ce sont des flash involontaires, du moins au début. Une sensation nous ramène à une sensation identique mais ancienne, éventuellement très ancienne et nous rappelle qu’elle n’a jamais disparue mais jusque qu’elle était éteinte comme ces gens dormants qui résident dans des pays étrangers en attendant d’être réactivés par une cellule d’espionnage. La sensation est incroyablement agréable: « cette essence n’était pas en moi, elle était moi. » Il faut réellement saisir cette phrase littéralement car Marcel Proust relie ici l’identité et la durée dans l’intuition du souvenir.
Est-ce que Gatsby a si tort que cela de soutenir que l’on peut revivre le passé? Ce passage suffit à nuancer efficacement la réponse à cette question: il a sûrement tort d’en faire un projet, une sorte de volonté qui de toute façon ne peut tourner qu’à l’obsession. Gatsby a tort de vouloir reconquérir Daisy parce qu’il l’a de toute façon à tout jamais conquise, de la même façon que la saveur de la madeleine est à tout jamais effective pour le narrateur. Elle est le narrateur. Finalement il est victime de cette illusion qu’est l’inversion des pôles de l’identité et des affects: ce n’est pas parce qu’il est Gatsby qu’il va pouvoir revivre son idylle avec Daisy mais c’est parce qu’il l'a vécu qu’il est Gatsby. Nous ne sommes que cela: une continuité évènementielle dans la continuité de laquelle rien jamais ne disparaît mais où tout peut s’oublier momentanément. Bref Gatsby a tort de vouloir revivre ce dont il ne vit en cet instant même que la mutation.
« Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher ? pas seulement : créer. Il est en face de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière »

Dans quelle dimension vivons nous les expériences qui nous arrivent? Nous dirions évidemment d’abord « dans l’espace », mais Bergson et Proust, eux nous répondent: « dans la durée ». Manger une madeleine, cela peut se décliner comme ça: un enfant met dans sa bouche un morceau de gâteau. Il n’est pas ce gâteau, pas plus que ce gâteau n’est lui mais il l’ingère. Point. 20 ans plus tard, ce même enfant devenu adulte mange à nouveau une madeleine. Même expérience mais l’enfant est devenu homme et n’est plus le même. Tout ce que Proust ici nous dit revient à réaliser que rien du souvenir ne serait possible si l’enfant n’avait pas goûté la madeleine dans le devenir et la continuité de sa différance. De l’enfant à l’adulte, il n’a fait que différer au gré d’un dynamisme que l’on appelle la durée. Le souvenir c’est lorsque cette dimension se manifeste à nous dans toute l’obscurité et l’insensibilité de cette durée. Nous sommes comme sidérés de nous éprouver constitué de ce flux là, le goût de la madeleine n’a pas cessé d’être là aussi dans le flux de cette différance dont on peut dire à la fois qu'il me singularise et qu'il me relie à tout ce qui existe par un lien aussi subtil, absolu qu'indétectable "à l'oeil nu".
Il faut revenir de cette perception de sa vie comme suivant un fil linéaire. C’est plutôt un jeu étrange de recoupements de points lesquels seraient les affects au gré desquels nous composons d’étranges figures. Nous ne sommes rien d’autre que cela des traits d’unions identitaires entre des affects dont certains reviennent et nous font alors réaliser la texture la plus authentique dans laquelle nous sommes tissés. Être c’est fondamentalement différer et coïncider dans le flux de cette différance avec une incroyable quantité d’affects, de substances, d’êtres, de matières, etc. Nous nous composons au fil de cette effectivité là, nous composons des agencements mais en même temps sommes composés par eux. Rien de tout ce que Proust décrit ici ne serait possible si la durée ne s’était pas enrichie de tous les affects éprouvés par le narrateur, lequel a forcément traversé cette incroyable masse d’affects de la perspective d’une autre hiérarchie, sociale, familiale, professionnelle? Mais parfois la vraie nature de notre être nous rappelle à l’ordre, c’est-à-dire à cette remise au zéro de nos affects des compteurs de notre existence. C’est toute la matière du roman que Proust va essayer ici de nous restituer étant entendu qu’elle a toujours été là parce qu’elle a toujours été lui: le narrateur, mais l’effort pour la déployer dans toute la justesse de sa texture affective, cela s’appelle « une oeuvre ». Or ce devenir brasse et embrasse absolument tout, sans distinction de genre, de règne, de nature. Seule la durée peut, par l’exhaustivité de sa dimension temporelle, être à la hauteur de ce défi artistique là.
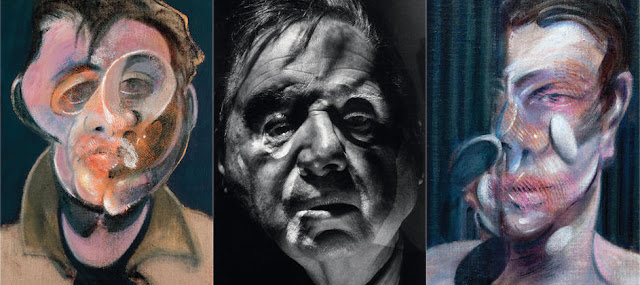






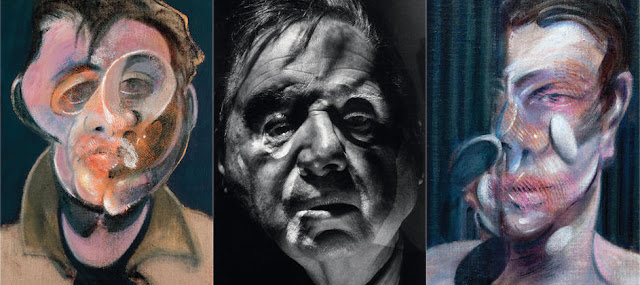
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire