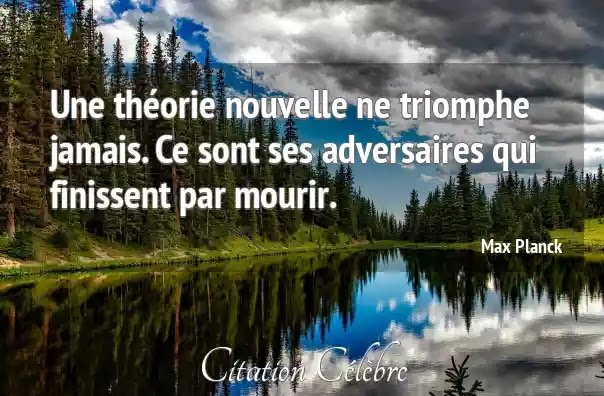Cette vidéo est une mine quasi miraculeuse de concepts à partir desquels comprendre la situation de crise dans laquelle nous sommes englué.e.s et réaliser à quel point la possibilité d’en sortir est aveuglante de « proximité » (au sens où nous sommes assis.e dessus) est dit, justifié, articulé, intégré dans une langue très claire et fertile en rapprochements possibles (avec la philosophie, la sociologie et l’histoire notamment). Evidemment les liens avec le texte que nous avons expliqué récemment de Philippe Descola sur la politique du vivant est à garder en tête dans le fil des démonstrations qui est ici suivi.
Oliver Hamant est biologiste à l’école normale supérieure de Lyon. Aristide Athanassiadis, comme à son habitude décrit le plan des thèses défendues dés le début de la vidéo. Cela permet éventuellement d’aller tout de suite à ce qui vous intéresse davantage mais la totalité de l’entretien est d’une richesse conceptuelle extrêmement motivante.
Le premier concept évoqué est celui de polycrises, c’est ce que nous vivons, à savoir que les crises écologique, sociale, climatique, économique, etc. s’engendrent de telle sorte que nous nous situons au coeur de la crise de toutes les crises. Qu’est-ce qui change par rapport à d’autres époques de crise? L’anthropocène, c’est-à-dire le fait que le facteur humain est devenu un paramètre du passage d’une ère climatique à une autre laquelle peut être considérée comme entièrement provoquée par un réchauffement causé par le dégagement des gaz à effet de serre des industries humaines polluantes.
Oliver Hamant fait alors référence à la proposition de Bruno Latour selon laquelle l’anthropocène nous fait enfin réaliser que la terre est ronde. C’est une chose de savoir qu’elle l’est et une autre d’avoir rendu la situation à ce point critique que s’activent autour de nous des boucles de rétroaction continuelles à la lumière desquelles on pourrait dire que tout se paie, en un sens. Les gaz à effet de serre ne se dissolvent pas. Ils créent des externalités négatives pour le vivant. Cela signifie qu’aucune marge de manoeuvre n’est plus aujourd’hui observable. La terre est ronde: cela veut dire qu’elle est une bulle au sein de laquelle tout est devenu dépendant de tout et que telle crise ici se répercute dans la crise d’un autre domaine là comme un effet domino ou papillon. La terre a toujours été ronde mais l’anthropocène nous fait évoluer de fait dans un milieu dont nous avons tellement usé les seuils de tolérance qu’à présent nous nous situons dans une sorte de membrane saturée au sein de laquelle tout se répercute. Nous vivons dans une sensibilité hyperactive de notre planète.
Or nous n’adoptons pas du tout les mêmes attitudes face à cette hypersensibilité pour la bonne raison que nous, les êtres humains nous n’en avons pas les mêmes perceptions selon nos milieux sociaux, nos environnements géographiques, nos options politiques, les influences auxquelles nous sommes soumis dans nos états respectifs. C’est ce qu’ Olivier Hamant appelle la synchronie des crises et la diachronie des perceptions. Alors que tous les indicateurs de polycrises autour de nous devraient logiquement nous inciter à adopter des mesures et des comportements identiques puisque, de fait, plus personne, mais vraiment plus personne ne peut se dire « pas concerné » , nous voyons plusieurs degrés d perception de la polycrises s’instaurer. L’une des nations les plus puissantes de la planète a placé le duo perdant d’un climato-sceptique et d’un transhumaniste délirant au sommet de l’état. C’est cela qui désigne « la synchronie des crises et la diachronie des perceptions »: l’écart incompréhensible et catastrophique entre un constat clair, sans ambiguïtés, tangible (les USA essuient des cyclones de plus en plus dévastateurs) et la réponse "pseudo politique" à ce point culminant de crise de l’habitabilité planétaire. Barbara Stiegler évoque dans cette perspective la notion de syndémie signifiant ainsi que la crise s’effectue d’abord dans le temps commun de l’épidémie plus que dans la totalité spatiale.
Pour bien se représenter la situation critique ou, mieux encore, réaliser que précisément il est très difficile de se la représenter, Oliver Hamant évoque la différence entre l’analyse des variations par la moyenne et cette même analyse par les écarts type. Quand une situation devient tellement désastreuse qu’on la mesure par les pics de la fluctuation plutôt que par la moyenne, parce que de fait ces écarts sont statistiquement plus parlants mais en même temps physiquement irreprésentables. Les pluies diluviennes à Valence en 2024 traduisent exactement cette impossibilité là. Il est de plus en plus difficile de se représenter ce qui, de fait s’effectue. C’est la notion d’objet supra liminaire que l’on retrouve chez le philosophe Gunther Anders (premier mari de Hannah Arendt): «J’appelle “supraliminaires” les événements et les actions qui sont trop grands pour être encore conçus par l’homme ». Nous pouvons causer des effets qui dépassent notre propre entendement. Anders pense évidemment à la bombe atomique, mais c’est tout aussi valable pour ces boucles de rétroactions climatiques dans lesquelles nous nous soumettons aux effets inconcevables des causes que pourtant nous avons conçues. Ce que nous vivons c’est le fait de nous situer à l’origine de phénomènes dont l’ampleur dépasse de cadre d’une compréhension humaine possible. En d’autres termes, nous vivons des phénomènes dont nous sommes la cause et dont l’ampleur dévastatrice n’est plus du tout compréhensible en termes de moyennes tout simplement parce que ce « moyennement » ne se donne jamais à éprouver en tant que tel. Nous allons faire l’épreuve de ce qui na jamais été vu, senti ni même pressenti. En fait, nous avons déjà commencé d’en faire l’épreuve.
Aristide Athanassiadis interroge alors Olivier Flamant sur des exemples d’évènements dont la cause est aussi insignifiante que les conséquences se sont révélées exceptionnelles. Crowdstrike est cette sorte de Bug qui s’est produit cet été pour tous les systèmes Windows à partir d’une simple erreur de mise à jour dans une entreprise de cybersécurité. Mais alors d’où ça vient? Comment rendre compte de cette hybris, de cette ignorance de la bulle hyper-saturée au sein de laquelle nous nous sommes enfermés nous-mêmes et subissons les boucles de rétroaction de phénomènes dont nous sommes les initiateurs? Comment en sommes nous arrivés à cette terre "ronde" au sein de laquelle tout ce qui se passe ici se répercute là?
Oliver Hamant cite l’agriculture, donc le néolithique (il y a 10000 ans). En passant de la cueillette à la plantation, nous avons créé les conditions d’une stabilité alimentaire locale. Quand vous donnez du pain à des pigeons vous créez immédiatement un périmètre dans lequel il y a du pain à foison, engendrant par là même dans un espace et un temps limité les conditions de la compétition entre les pigeons (c’est vraiment éclairant de remettre tous les slogans débiles de l’hyper-compétitivité sur le niveau de cette image: quand nous entendons de la part de spécialistes de gestion des propositions qui ont l’air très intelligente sur les conditions de compétitivité des entreprises, nous avons affaire à des pigeons dans un parc qui sont en train de sa battre autour des miettes données par une vieille dame). "C’est une propriété systémique" : il n’est rien là qui soit spécifique aux humains: à partir du moment où l’on crée une sorte de bulle sécurisée au sein de laquelle l’alimentation est localement stabilisée, tout est réuni pour créer les conditions d’une compétitivité acharnée.
Cette stabilisation s’est maintenue, voire accrue jusqu’à la révolution industrielle. Ce qui est en train de se passer c’est que le fondement énergétique d’une telle démarche n’est plus aujourd’hui viable parce que la terre est maintenant plus ronde, plus circularisée dans une boucle de rétroaction.
Il faut vraiment comprendre ici la référence d’Olivier Flamant au mythe de la performance, à cette idée complètement fausse selon laquelle la performance implique du bien être, ou du mieux être. Ici encore il faut réaliser tout ce qu’implique le rapport entre performance et fragilisation afin de saisir ce qui impose à l’évolution de nos sociétés une dynamique ouvertement et absurdement suicidaire (la performance c'est ce qui suppose une faille).
Nous sommes dans l’ère des rétroactions, ce qu’il convient peut-être de prendre de façon vraiment philosophique parce qu’après tout cela ne signifie rien de plus ni de moins que ce que Spinoza déjà signifiait à sa façon en affirmant que « l’être humain n’est pas un empire dans un empire ». Exister est « composer », adopter un mode d’être grâce auquel il nous est également donné de libérer la puissance d’agir des Autres et par "autres", il convient d’entendre absolument outes et tous les autres. Aller sur une planète morte (Mars) pour la ramener à une forme de vie humanisée est un projet « dément » qui ne peut naître que dans l’esprit d’une personne intellectuellement déficiente.
La performance est l’addition de l’efficacité et de l’efficience. Il s’agit de faire toujours mieux avec toujours moins. Ici un parallèle peut être tenté. Dans « libres d’obéir » Johann Chapoutot définit exactement dans les mêmes termes le développement des techniques de gestion nazies, ce que l’on doit appeler le « management nazi » (certains pensent que nous en avons fini avec le nazisme, non seulement l’actualité récente nous prouve que non, mais le nazi a parfaitement pu diffuser dans le monde ce qui constitue l’une de ses pires idées: le management, les techniques de manipulations du "matériau humain". Puisque il y a polycrises, il faut questionner ce modèle là avant toute autre chose. Les boucles de rétroaction dans lesquelles nous sommes désormais radicalement coincé.e.s imposent que nous réfléchissions et abandonnions définitivement ce qui nous y a conduit à savoir la fragilisation des écosystèmes c’est-à-dire précisément ce culte de la performance.
La performance et l’évaluation sont des dysfonctionnements qui ont fini par se glisser dans les mentalités d’une façon insidieuse et absolument totalitaire. Vous vous lavez les mains dans les toilettes d’une aire d’autoroute et vous pourrez apercevoir une petite machine à sondage qui vous interrogera sur ce que vous avez pensé de la propreté des lieux, histoire de pouvoir « améliorer » le service éventuellement fragiliser leur emploi. Vous venez de dialoguer avec l’employé de tel ou tel service communicant et vous recevez un mail vous demandant de juger votre entretien. Ce sont là des micro-indicateurs de performances auxquels il est vraiment urgent de ne pas répondre, ne serait-ce que parce que de toute façon ils vous situeront tôt ou tard du coté des évalué.e.s, si ce n'est pas déjà fait.
Olivier Hamant utilise des termes qui ne sont pas forcément d’une compréhension aisée. Le terme « incrémental » désigne des palliers réduits de progression grâce auxquels un ensemble ou un système ou une discipline n’en finit pas d’être optimisé petit à petit sans qu’un changement brusque ne bouleverse la donne. Les scientifiques et la science en général sont aujourd’hui l’objet de contrôle visant à évaluer sans cesse leurs progrès sans qu’une innovation puisse enfin bouleverser cet progression mortifère et suicidaire. L’université de Saclay a été conçue pour répondre parfaitement aux critères de Shangaï et booster les indicateurs d performance de la France à l’échelle internationale, mais elle a été construite sur les meilleures terres cultivables de la France. Cela signifie que l’on va structurer les cadres, futures élites de la nation sur des territoires écologiquement perdus, comme un symbole éclatant de la performance abstraite, utopique, absurde, caduque. La loi de Goodhart permet de mieux saisir le sens profond de cette évolution: « Quand une mesure devient un objectif , elle cesse d’être fiable. » Que signifie-t-elle? Quand l’évaluation d’un système devient l’objectif que l’on donne à ce système pour atteindre un certain niveau, elle cesse d’être fiable parce que vous n’êtes plus en train de mesurer sa capacité (puissance) mais de le contraindre à atteindre un objectif que VOUS lui imposez (pouvoir). Cette loi est réellement une arme précise pour dénoncer les objectifs déments qui sont fixés dans certaines administrations. Très récemment encore, Ellon Musk a diffusé pour les fonctionnaires de l’état fédéral des EU l’obligation de répondre à un questionnaire sur la performance hebdomadaire intitulé « qu’avez vous fait la semaine dernière? »
« Celui qui a atteint son objectif a raté tous les autres.»: c’est l’adage Zen cité par Olivier Hamant en renfort de la compréhension de cette loi. Nous pourrions également rappeler ici Montaigne:
- « Je n’ai rien fait aujourd’hui
- N’avez vous pas vécu? C’est la plus illustre et la plus fondamentale de vos occupations. »
L’exemple du sport qu’il évoque par la suite est excellent par l’incroyable effet de perspective qu’il provoque. Imaginez que l’on distingue clairement le domaine du sport de celui de la compétition et que la pratique d’une activité sportive ne soit plus en aucune façon considérée comme quête de « victoire » mais tout simplement comme "accomplissement de sa puissance physique". Qu’on y réfléchisse un peu: nous sommes absolument conquis par le jeu de Nadal. Qu’est-ce que cela veut dire? Que finalement nous sommes séduits par le spectacle d’un être humain décidant de pousser son corps à des limites impraticables dont ses muscles, ses articulations, ses os paient le prix fort pour qu’il gagne des sommes astronomiques en faisant voir des points hallucinants et spectaculaires. Bien! Nous regardons un organisme humain se détruire consciemment pour répondre aux critères de la réussite sociale accélérée et pour peu que nous soyons vraiment totalement débiles, nous appellerons ça « réussite ».
Ici il faut vraiment comprendre la profondeur de champ de la perspective d’Olivier Hamant, biologiste: nous ciblons l’animal humain en empruntant enfin le crible d’interprétation du Vivant. Qui dit performance ou optimisation dit nécessairement fragilisation. Vous ne pouvez pas optimiser une aptitude sans fragiliser un ensemble ou une autre aptitude. « C’est vrai pour une étoile, une fourmilière et nécessairement pour les sociétés humaines. » Nous ne pouvons pas trop réfléchir aux implications d’une telle affirmation.
L’entretien prend alors une direction vraiment philosophique: « pourquoi l’optimisation à tout crin ? » Pourquoi partons nous du principe que notre existence, notre rapport au monde et ce monde lui-même doivent être optimisés? Optimiser signifie « accélérer » et cette accélération induit la question de savoir pour aller où. Et la réponse est assez simple: le terme, la mort au sens de terminaison. Pourquoi cette accélération vers ce que nous savons toutes et tous être le terme? Ici je me permettrai de rajouter quelque chose qui pointe un peu plus que ne le fait Olivier Hamant le transhumanisme. Il s’agit d’épuiser le plus vite possible notre durée de vie « naturelle » (notre conatus, notre désir d’exister) de façon à entrer dans cette zone totalement démente, fausse, utopique qu’est « la vie rallongée », artificielle, technologique, entrer enfin dans la côté terrifiant et démesuré du deinos de Sophocle.
Ce qui est réellement intéressant c’est que ce comportement de l’optimisation exclusive n’est peut-être pas à chercher ailleurs que dans le vivant lui-même. Tout être vivant immergé dans un milieu riche et stable fait de l’optimisation. Qu’est ce qui caractérise alors l’être humain dans la nature résolument exponentielle de cette donne de l’optimisation qui finalement est celle de tout être vivant ?
Déjà Jean-Jacques Rousseau dans "Discours sur l’origine de l’inégalité" donnait une piste en affirmant que l’humanité ne mesurait pas les conséquences toxiques de l’agriculture et de la métallurgie (rappelons ici que certains peuples se sont développés sans ces deux inventions comme les tribus indiennes d’Amérique du nord avant d’être délogées et massacrées par les colons). Quelque chose, donc, se passe au Néolithique mais à cela s’ajoute l’écriture qui permet à l’humanité de se projeter sur le temps long (et ici c’est finalement Platon qui nous avertissait avec sa réflexion sur le pharmakon telle qu’elle a été reprise par Jacques Derrida).
L’écriture est un pharmakon dont nous avons probablement du mal à relever la toxicité même si Claude Lévi-Strauss l’avait parfaitement détectée. Ici l’écriture est le support d’une projection des acquis de son espèce dans le temps long et nous n’avons pas vraiment jusqu’à maintenant relevé l’équivalent de ce traçage qu’est l’écriture dans les autres espèces vivantes. Il y a quelque chose ici de cette combinaison entre écriture et stabilisation de conditions d’abondance qui définit spécifiquement notre espèce.
Ici encore nous pouvons opérer quelques rapprochements avec ce que Bernard Stiegler (le père de Barbara dont il était question au début de l'article) appelle "les rétentions tertiaires" en reprenant un concept de Husserl. Les rétentions primaires désignent la mémoire à court terme, celle qui fait que vous vous souvenez du début de l'article, voire du début de la phrase. Rien n'est envisageable du point de vue de la compréhension de quelque énoncé que ce soit sans cette mémoire là. Il existe aussi la rétention secondaire qui est constituée par les souvenirs. La rétention tertiaire regroupe tous les supportes mémoriels technologiques, externes, tout ce qui fait que finalement l'IA est en un sens le dernier rejeton de l'écriture. Nous vivons une époque durant laquelle les rétentions tertiaires écrasent littéralement les deux premières accélérant un mouvement qualifié par Stiegler de "prolétarisation des savoirs". De la même façon que le capitalisme a exclu le travailleur de la compréhension du travail en lui imposant de se vendre comme force aveugle de travail il et agent passif d'une production dont le fonctionnement la finalité lui échappait, nous utilisons aujourd'hui des techniques que nous ne comprenons pas. Le chauffeur de taxi peut conduire un client dans paris sans avoir la connaissance intrinsèque des rues et du réseau parisien. La performance étrangle et réduit à néant aussi la robustesse.
Ce que rend possible l’écriture, c’est donc la spéculation sur la performance (quelque chose que nous devons relier à la chrématistique commerciale pour Aristote). On peut ici citer avec Olivier Hamant la permanence délirante de modèle économique néo-libéral et ces auteurs qui soutiennent des thèses absolument intenables: Hayek, Friedman et William Nordhaus selon lequel la température moyenne du globe pourrait d’élever de 3,5 degrés alors que 2 constitue déjà en soi un seuil absolument catastrophique, au-delà duquel les dommages sont irréparables. William Nordhaus a été prix Nobel d’économie ce qui en dit long sur la mythologie de l’optimisation et de la croissance opérant au coeur de toute idéologie libérale.
 |
| Dans quel monde vit William Nordhaus ? un monde dont la température moyenne peut monter de 3,5 degrés. |
Si nous y réfléchissons cela signifie que le modèle économique enseigné dans toutes les écoles de commerce est non seulement faux scientifiquement mais suicidaire écologiquement, biologiquement et situé « éthiquement » dans l’hybris du deinos Sophocléen.
Aristide Athanassiadis fait alors une remarque d’une très grande justesse: ce qu’opère des économistes néo-libéraux dans la veine de William Nordhaus ne consiste ni plus ni moins qu’à rendre scientifique un préjugé économique, une croyance totalement infondée, contraire aux observations les plus élémentaires aboutissant à des conclusions vraiment scientifiques exactement opposées. Aveuglée par une telle « foi » (car le capitalisme peut dés lors se comparer à l’intégrisme d’une forme de religion) l’humanité accélère comme une voiture qui foncerait vers une falaise. C’est au sens propre une « déroute » et dans cette déroule l’impulsion récente donnée par l’accession de Donald Trump à la maison blanche est un facteur d’aggravation vraiment exponentiel dont l’Europe serait bien inspirée de prendre vraiment la mesure.
Les cirripèdes - Pour illustrer dans le comportement des animaux ce qui a été posé sur les milieux abondants et stables (où naît la performance). Hamant utilise Darwin et les bernacles parmi lesquels se trouve les cirripèdes parasites de la peau du requin. Le cirripède est connecté sur les fluides et le sang du requin exactement comme nous avec la terre (« Les humains sont la maladie de peau de la terre » - Nietzsche). A force de vivre dans ces conditions qui lui garantissent une forme d’abondance, le cirripède a muté perdant tous les organes qui ne sont plus nécessaires. Il se rapproche alors d’une espèce de bloc ancré, sédimenté dans la peau du requin. Dés lors il perd toute possibilité d’autonomie , et devient dépendant entièrement de la vie de son hôte. Il mourra avec le requin. C’est un exemple génial parce que la stratégie du cirripède est exactement celle de l’optimisation du management: faire toujours mieux avec toujours moins et donc supprimer tout ce qui n’est pas utile jusqu’à se racornir dans une espèce de bloc sédimenté qui mourra avec l’hôte parasité. L’extractivisme optimisé n’est ni plus ni moins que le mouvement exponentiel vers sa propre disparition.
Les champignons illustrent un tout autre rapport qui précisément n’est plus celui du parasitisme unilatéral mais de la symbiose puisque qu’ils apportent de l’humidité à l’arbre qui en retour leur donne du sucre de telle sorte qu’un intérêt commun relie les champignons aux arbres. Devenir des parasites symbiotiques: c’est là un objectif dont la terminologie n’est peut-être pas très porteuse mais dont le sens est extrêmement riche.
Cette structure qui relie parasitisme et symbiose peut donc se retrouver dans le vivant mais il existe une différence cruciale, à savoir que pour la plupart d’entre elles, elles sont susceptibles de devenir des pores dormantes. On peut ici se rappeler de la tique qui, tant qu’elles n’est pas mise en contact avec les trois affects désinhibiteurs, peut rester 18 ans dans un état léthargique. Mais l’être humain n’est pas doté d’une telle possibilité.
La dynamique de l’optimisation est donc une stratégie parasitaire et naturelle qui a incontestablement son utilité dans le vivant. Les virus par exemple redistribuent la donne génétique de l’ADN et à ce titre dont un facteur positif d’évolution.
Le problème humain vient de ce que 1) ce parasitisme est conscient 2) qu’il va donc profiter de l’écriture (par écriture il faut aussi entendre tout ce que du registre du support mémoriel de l’inscription, d’un certain type de prorogation fondé sur l’informatique, le grammatique du programmatique). Dés lors le rapport au temps va être décisif et porteur de toxicité. Aux problèmes auxquels nous sommes confrontés nous allons apporter des solutions qui vont se projeter dans un « long termisme » délirant, « techno-solutionnant » (aller sur Mars, s’implanter une puce dans les neurones, avaler 150 cachets par jour et autres débilités) .
De fait les spéculations délirantes sur le temps sont malheureusement possibles alors que selon Hamant la solution consiste précisément à ne plus se concentrer sur le temps mais sur l’espace. Aux problèmes qui désormais se posent à nous sur le court terme il faut répondre en s’ancrant dans le territoire et pas du tout en inventant des projets hallucinants sur le long terme. Qiuand on manque de temps il faut se reconnecter à son espace, un peu sur le modèle de Pénélope qui est victime d’une pression des prétendants lui intimant de se décider urgemment dans le temps donc et qui se concentre sur l’espace du métier à tisser, dans le périmètre très circonscrit d’une action dans un lieu donné (mais à partir duquel on peut soulever chronos par aiôn).
C’est probablement le passage le plus éclairant et le plus riche de cette vidéo qui l’est en totalité mais c’est le fond du message d’Oliver Hamant qui se délivre dans ce moment là (27:56) : se concentrer sur un espace dans un monde incertain, c’est là et vraiment là que se déploie l’incroyable puissance du vivant, celle dont il s’agirait de nous inspirer. Les êtres vivants parviennent à créer les conditions de leur robustesse dans un univers fluctuant et incertain.
La plupart des biotopes sont fragiles, instables, dotées de conditions qui ne garantissent pas une stabilité sur le long terme si bien qu’il importe à l’être concerné de se doter de la robustesse nécessaire à demeurer. Mais comment y parviennent-ils?
Précisément en n’étant pas performants. La sélection des espèces ne se fait donc absolument pas par l’écrasement des autres ou autres niaiseries du prétendu darwinisme social, mais par la robustesse et cette robustesse se caractérise par ce qu’Oliver Hamant caractérise comme capacité à mettre du jeu dans les rouages. C’est fascinant et très Bergsonien dans l’esprit. Il n’est pas du tout question pour les espèces vivantes de « survivre », mais de vivre, de décliner le fait de vivre de la façon la plus ouverte aux variantes possible en créant des poches d’inutilité, d’incohérence, d’improvisation , etc. Le vivant n’est pas pris capturé dans des critères de survie (contrairement à ce que croient la plupart des êtres humains) mais ils créent continuellement de nouvelles modalités de ce que vivre est susceptible de devenir. Finalement le mot d’ordre du vivant n’est pas du tout: « il faut que…. », mais « et si on essayait…. ».
On innove dans le temps imparti par les marges de manoeuvre que l’on se donne. Il n’est question que d’être viable et pas du tout de survivre à tout prix. Le vivant est animé du souci constant d’élargir la palette de ce que vivre pourrait être. Comment diversifier le fait de vivre dans un temps donné? C’est ça la dynamique fondamentale de la vie. Quelles sont les extrémités de la vie possible? Pour un être humain par exemple ne pas manger pendant quinze jours est possible (même plus mais après sa faiblesse sera telle qu’il tombera ou perdra conscience de plus en plus). Cela veut dire que dans ce cadre là de quinze jours de nouveaux rythmes d’alimentation ou de non-alimentation sont à explorer (avec des observations assez fascinantes à faire en terme de perception notamment). Pour le dire plus clairement il existe donc des fluctuations au fil desquelles les biotopes sont dotés d’une amplitude temporelle plus ou moins longue, il est donc bien question de ne pas disparaître au gré de ses fluctuations et donc d’atteindre de la robustesse, mais cela ne passe pas du tout par une espèce de dépassement optimisé et forcé de la durée de vie mais par l'exploration de tout ce que peut générer de nouvelles attitudes telle espèce vivante dans ce temps là pour le vivre et non lui survivre.
Ces quinze jours de jeûne possible sont donc vraiment intéressants parce qu’ils attestent de l’activation en nous d’une puissance de résistance aux fluctuations, par quoi nous faisons bel et bien partie de cette dynamique de l’innovation du vivant.
Il y a donc un malentendu très profond sur le Darwinisme et sur la sélection naturelle. S’il s’agit bien de pointer l’existence d’un processus de sélection du vivant, il convient de ne pas minorer pour autant l’hétérogénéité du vivant, sa capacité à travailler en « labo », d’une certaine façon. Nous pouvons nous interroger sur certaines caractéristiques de notre corps en remarquant l’inutilité de telle ou telle partie assez excentrique mais nous ne sommes pas vraiment enclins à envisager qu’en fait le vivant est en train d’improviser des morceaux, des moignons, du cartilage, de la fibre nerveuse, pulmonaire, des cellules, etc.
Finalement le vivant c'est un peu une maison construite par Numerobis dans Astérix et Cléopâtre d'Alain Chabat. Lorsque un client difficile demande des comptes sur la présence d'une porte qui n'est soutenue par aucun étage, Numerobis répond: "j'anticipe" et c'est bien comme cela que le vivant "tente des trucs", comme un architecte totalement nul du point de vue de la performance mais trés visionnaire sur le long terme de la robustesse.
En fait, Darwin insiste sur ces deux moments:
- Il y a bien des moments d’optimisation, de prédation dans le vivant (la chasse)
- Mais aussi et surtout de longs temps d’hétérogénéïsation durant lesquels le vivant travaille plutôt sa robustesse, la possibilité d’explorer de nouvelles variables de sa gamme phylogénétique.
Prenons l’exemple du paon dont la queue est certes magnifique mais assez peu efficiente en terme de camouflage à l’égard des prédateurs. C’est délirant mais au très bon sens du terme. Nous pourrions ici mettre en perspective les thèses darwiniennes au gré de deux axes: l’optimisation (sélection des espèces) et improvisation (exploration de toutes les gammes possibles des variables au sein d’une espèce, d’un biotope). Nous avons privilégié l’un aux dépens de l’autre, ce qui a donné les plus beaux fleurons du darwinisme social (écrasement des pauvres par les riches) aujourd’hui tristement en activité de l’autre côté de l’Atlantique.
Les thèses d’Olivier Hamant sont vraiment extrêmement porteuses: nous ne cessons pas de mettre au premier plan de nos préoccupations la survie à tout prix, le travail salarié, les morts d’ordre soulignant l’extrême dureté de « la vie » (qui ne fait pas de cadeaux, qui est cruelle, dure, etc) alors que le vivant est de l’improvisation constante à tous les étages. Paul Valéry dit: « le vent se lève, il faut tenter de vivre »: oui mais cette tentative de vivre s’effectue sur le fond d’une vie qui elle-même, dans une perspective biologique pure et brute est aussi en pleine tentative d’improvisation fondamentale de ce que vivre peut vouloir dire et devenir.
Olivier Hamant a ainsi défini sept principes à l’oeuvre dans le vivant: « Lenteur - Inefficacité - Hétérogénéité - Incohérence - Incertitude - Redondance - Inachèvement ». Il serait extrêmement parlant et édifiant d’interroger à l’aune de ces sept caractéristiques le travail des artistes, tous arts confondus. On voit mal comment mener à bien une oeuvre sans passer par ces sept moments. Réfléchissons à ces sept…comment les appeler?… « Défauts » mais justement ils sont exactement le contraire d’un défaut. Ces sept piliers de la robustesse sont point par point l’exacte opposé de la performance. Quelque chose de leur déclinaison semble également aller de pair avec l’individuation. La performance est l’excellence même de l’individualisme alors que la robustesse se laisse décrire comme « le quotidien » de l’individuation.
Aristide Athanassiadis pose alors le problème de l’IA qui se trouve être le corollaire aujourd’hui de la performance. Olivier Hamant utilisera l’expression de machine à désastre combinant deux dysfonctionnements graves et rédhibitoires. Le premier est celui qu’il appelle métaphoriquement « s’endormir au volant ». A force de miser sur l’IA, ne peut que se créer une sorte de confiance aveugle aboutissant nécessairement à l’accident, notamment parce que la collecte anarchique des données ne peut se concevoir sans dysfonctionnement: si l’IA se charge des aiguillages dans un aéroport, il est absolument impossible que des accidents de ne se produisent pas: opter pour cette techno-solution, c’est d’emblée accepter un certain nombre de morts humains sacrifiés à cette nouvelle pratique comme un rituel inca.
Le deuxième défaut est encore plus toxique c’est ce que l’on pourrai appeler l’uniformisation génétique. L’IA est un outil informatique se nourrissant de données informatiques. L’IA est une machine dont le contenu et l’éditeur de contenu sont les mêmes. Bref c’est de la consanguinité à l’état pur. L’IA est un instrument dont la pertinence et la fiabilité ne peuvent que décliner de la même façon qu'une lignée pratiquant l'inceste ne peut que dégénérer dans les dysfonctionnements de consanguinité génétique.
Il semble assez évident que l’IA est du côté de la performance davantage que de celui de la robustesse. Ce qu’il faut comprendre ici en observant tout simplement le vivant c’est le fait que lorsqu’il y a du point de vue des ressources l’instauration d’une localité stable (comme le pain pour les pigeons dans une zone du parc) alors le vivant stimule la performance mais lorsque le milieu est fluctuant incertain le vivant se tourne vers la robustesse. Or en ce moment c’est comme si les humains choisissaient la performance alors que nous sommes en train de pencher vers un univers de plus en plus fluctuant. Sans aucun doute l’IA fait partie de cette dérive que l’on pourrait qualifier en un sens tout à fait nouveau « antibiotique » (contre l’évidence du vivant)
L’entretien s’oriente alors vers la question fondamentale du « comment? ». Comment faire en sorte que l’humanité finisse par apprendre du vivant que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés ne se résoudront pas avec la performance mais peuvent et doivent être traités avec la robustesse?
(Une petite parenthèse ici: nous avons récemment opéré la distinction entre la puissance et le pouvoir dans le cours sur la morale, le droit et la justice. Autant Hobbes ne raisonne qu’au sein de la potestas (pouvoir), autant Spinoza, lui, est du côté de la potentia (puissance). Il est vraiment troublant de réaliser à quel point la performance est du côté du pouvoir et la robustesse de celui de la puissance. Nous n’insisterons jamais suffisamment sur l’importance de ce que signifie la puissance aussi bien pour nous que pour le vivant)
Aristide Athanassiadis évoque le principe de Planck. De quoi s’agit-il? Dans son autobiographie scientifique Max Planck écrit:
« Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires et en leur faisant voir la lumière, mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir et qu'une nouvelle génération grandit qui la connaît…Une innovation scientifique importante fait rarement son chemin en gagnant et en convertissant progressivement ses adversaires : il arrive rarement que Saul devienne Paul. Ce qui se passe, c'est que ses opposants s'éteignent progressivement et que la génération montante se familiarise avec les idées dès le début : un autre exemple du fait que l'avenir appartient à la jeunesse. »
En d’autres termes, il ne sert pas forcément à grand chose d’user notre salive contre les idéologues de la performance qui littéralement envahissent l’espace médiatique, ou bien contre les tenants du dogme de l’économie libérale qui disent réellement n’importe quoi comme William Nordhaus. Il est essentiel de se tourner plutôt vers les jeunes générations. Donald Trump a 78 ans (ça explique certaines choses) et le mieux que nous puissions faire en suivant ce principe c’est d’attendre, sachant que les jeunes générations manifesteront infiniment plus d’i intelligence et de « robustesse » que Donald.
Sur ce point les propos d’Olivier Hamant sont extrêmement rassurants. Le délire actuel des défenseurs de la performance et en premier lieu des milliardaires qui produisent des efforts ultimes et désespérés pour confisquer les médias et faire le plus possible obstacle aux idées progressistes sont la manifestation d’un chant du cygne. Nous vivons la chronique de la mort annoncée du monde de la performance. Rien ne nous empêche d’oeuvrer le plus possible à notre échelle à favoriser toutes les initiatives allant dans le sens de la robustesse, de la puissance contre le pouvoir et la performance.
Oliver Hamant se risque donc à une prédiction à la lumière de laquelle les ultra performants vont nécessairement chuter dans les années à venir, cela signifie que toutes les entreprises structurées autour de ce mythe sont déjà en train de péricliter. Il n’y a évidemment pas lieu de s’en réjouir immédiatement au vu des licenciements et des drames humains que cela va engendrer mais cette « prophétie » est imparable. Elle se réalisera nécessairement avec son cortège de tragédies. De plus il existe dans l’ombre des projecteurs médiatiques de plus en plus d’initiatives locales attestant de la compréhension par les jeunes générations de la nécessité de concentrer ses efforts vers la robustesse. « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse » C’est exactement la réalité médiatique que nous vivons en ce moment avec cette sorte d’exacerbation de la performance dans le pouvoir médiatique et politique et la clandestinité du monde associatif de la robustesse.
Cette vidéo est vraiment à écouter et à réécouter dans cette perspective là, celle du pharmakon. « Dans le péril croît aussi ce qui sauve » Holderlin. Jamais les raisons de nous réjouir n’ont finalement été aussi fortes qu’en assistant au spectacle délirant d’un terra-formateur de Mars faisant le salut nazi à l’investiture d’un vieillard obèse pour l’Ehpad de la maison blanche. C’est trop radical pour ne pas être insignifiant. On n’effectue pas des manifestations aussi outrancières sans se sentir en danger. C’est comme si la performance était animée à un degré de conscience i infinitésimal de la perspective de sa fragilisation grandissante.
Il nous faut être attentif.ve.s à tout ce qui e passe en-dehors des radars de l’ultra-performance. Des poches de robustesse ont toujours été au rendez vous des crises et nous pouvons évidemment la dernière très grosse fluctuation en date à savoir celle de la pandémie durant laquelle les services publics ont été les seuls à continuer à tourner. Même les salariés du privé ont été indemnisés par l’état. Nous en avons parlé récemment avec notamment cet excellent extrait de « la vie de Brian ». Les services publics ne font pas de bruit. Un fonctionnaire ne travaille pas pour aller sur Mars ou créer des autoroutes galactiques. La destruction quasi totale des services publics aux EU entreprise par les "Laurel et Hardy" (mes excuses à Stan Laurel et Oliver Hardy ainsi qu'aux membres de leur famille pour ce rapprochement discutable) de l’autre côté de l’Atlantique va avoir des répercussions absolument terribles pour les plus défavorisés parmi lesquels Trump compte une bonne partie de ses électeurs. Si nous pouvons tenter de voir au-delà de ses tragédies individuelles extrêmement dommageables, ce qui oeuvre dans cette idéologie démesurée de la performance c’est le chant du cygne de la pensée libertarienne.
Il existe donc une multitude de solutions à la polycrises que nous vivons actuellement mais toutes ne sont pas viables. Comment sélectionner les plus robustes et les moins performantes ? Par le « stress test ». Il s’agit de questionner la solidité des solutions face à des catastrophes (de plus en plus probables: inondations, virus informatique, flambée des prix des ressources énergétiques). « Le stress test permet de s’acculturer au monde fluctuant »: cette phrase d’Olivier Flamant est très éclairante. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à intégrer dans notre « logiciel » les dysfonctionnements qui font déjà partie du monde fluctuant.
Olivier Hamant évoque plusieurs régions ou villes appliquant précisément les conclusions qu’il retirent de ses connaissances en biologie et de leur application à la polycrises. La Wallonie, les villes de Grenoble et de Lyon commencent à réfléchir à la façon d’intégrer cette robustesse biologique telle qu’elle opére dans le vivant à la gestion des villes et des départements face aux fluctuations de plus en plus fréquentes. Finalement les fluctuations ce sont ces écarts types dont il était question au début et elles se traduisent concrètement par la possibilité de catastrophes causées par les cyclones, les inondations, les tsunamis, etc. Il serait peut-être assez tentant de ne les attribuer qu’à un côté de l’échiquier politique pendant plutôt vers la gauche mais la robustesse est apolitique. Il existe d’ailleurs des valeurs traditionnellement situées à droite qui peuvent parfaitement être intégrées à cette nouvelle donne, notamment par rapport à l’ancrage dans un territoire. C’est tout l’enjeu de l’agriculture, profession habituellement située à droite (importance des traditions, du conservatisme, etc.), mais évidemment on peut parfaitement anticiper sur ce que serait une agriculture de la robustesse, surtout lorsque on réalise tout ce que l’idéologie de la performance a fait perdre au monde paysan (pesticides, épuisement des terres arables, prix de revient des récoltes - la crise actuelle de l’agriculture est incontestablement provoquée par la performance. En revenir induirait la fin de le FNSEA). Mais justement ce qu'il faut retenir c’est que la situation est suffisamment urgente et grave pour que les obédiences à un parti politique cessent. De fait le monde est devenu fluctuant, et par conséquent l’observation du vivant nous dit clairement que nous en sommes plus en capacité de concevoir les modalités de notre habitation selon le pattern de la performance. Apprendre du vivant c’est s’orienter vers la robustesse, donc vers la lenteur, l’Inefficacité, l’hétérogénéité, l’incohérence, l’incertitude, la redondance, l’inachèvement.
Chacune et chacun de nous peut retenir dans ses options de vie et dans sa façon de conjuguer son existence à un mode fluctuant telle ou telle donnée, telle ou telle considération soulignée par Oliver Hamant. Beaucoup de choses s’éclairent quand nous mesurons le malentendu sur l’évolution des espèces de Darwin qui est très exactement celui-ci: l’écrasante majorité de ses lecteurs (pour des raisons qui ont sûrement à voir avec ce que Descola désigne du terme de naturalisme nous pourrions parler d’extractivisme industriel ) ont fait pencher du côté de la performance (comme si la sélection naturelle induisant l’agressivité et la démesure) ce qui en réalité se situe du côté de la robustesse. Ringardiser la performance, c’est ce qui n’a peut-être pas besoin de tant d’efforts que cela. Le registre lexical des idéologues de la performance est assez indigent par lui-même: « il faut avancer », « en marche » « make America great again », etc. Le principe de Planck est assez clair pour nous orienter vers un ethos qui se trouve précisément consister dans l’attention que nous portons assez naturellement vers la puissance plutôt que vers l’accession au pouvoir. De fait, il est bon nombre de déclarations des addicts de la performance qui n’ont plus d’autre résonance que celle des médias mainstream et qui, hors de cette sphère finalement assez étroite, sont dépourvus d’écho, ne portent déjà plus assez loin. Il n’y a vraiment pas lieu de leur accorder trop d’attention, pas davantage qu’aux effets d’annonce et aux saluts nazis d’outre atlantique. Il est en nous un vis à vis toujours disponible, incroyablement plus pertinent que n'importe quel IA et surtout beaucoup plus fiable, c'est l'intelligence du vivant. Travailler en soi cette écoute, cultiver le tact de laisser intact cette fibre prodigue de la robustesse, lui donner simplement de la voix, de l'assentiment, de la portée par nos actions plus que par nos oppositions, c'est tout ce vers quoi nous pouvons diriger nos efforts. Il va de soi que la référence à Spinoza n'a pas cessé d'accompagner, de suivre, voire d'anticiper les propos d'Olivier Hamant.