« Je crois profondément que la véritable gratitude est une façon de remercier la vie plus qu’une personne donnée, elle exprime la joie d’être vivant. C’est l’antithèse radicale du « je n’ai pas demandé à naître donc la vie, le monde, les autres me doivent tout », qui caractérise l’ingratitude absolue. La gratitude suppose une responsabilisation face à sa propre existence : quelle est ma part dans ce qui m’arrive ? Persuadé que les autres – mes parents, mon conjoint… – doivent veiller à mon bien-être, il m’est impossible d’accéder à la gratitude. Or, nous sommes entrés dans l’ère des victimes, qui estiment que le bonheur leur est dû et qui exigent réparation si ce n’est pas le cas ! Je crois que ce registre « victimaire » est attaché à l’illusion infantile que le sort gâte davantage les autres et qu’il devrait toujours y avoir une solution à la souffrance. Je ne nie pas que certains êtres aient subi de terribles préjudices. Ni que se prendre en charge soit facile dans cette société peu solidaire, où l’exclusion survient très rapidement. Toutefois, la croyance que nous méritons d’être par principe plus heureux nous empêche de remercier la vie pour ce qu’elle nous donne. D’ailleurs, se satisfaire de son sort est presque honteux, synonyme de faiblesse, de manque de combativité. Je perçois une sorte de rancœur, de ressentiment général. L’ingratitude ce n’est pas d’omettre de dire merci. C’est le refus de reconnaître le bien qui arrive dans notre vie. Reconnaître ce qui fut bon fait partie d’une attitude réaliste qui permet aussi de reconnaître les blessures et les échecs : cela est nécessaire pour avancer.
Freud a posé l’idée d’une dette de vie dont nous héritons en naissant. L’un de ses patients, surnommé l’Homme aux rats, essayait de rembourser une dette imaginaire à une personne qui ne lui réclamait rien. En fait, il s’efforçait de régler de façon fantasmatique les dettes, réelles, de son père. Nous sommes ici dans un registre névrotique. Cependant nous devons la vie à nos parents. Et certains se demandent jusqu’à leur dernier jour comment rembourser cette dette. Les uns s’acharneront à gâcher leur existence, façon de dire : « Je ne vous dois rien, et si je vais d’échec en échec, c’est à cause de vous. » C’est souvent le cas quand les relations parents-enfants sont trop ambivalentes, qu’elles s’accompagnent de vœux de mort inconscients, de chantage affectif. Les autres, plus positivement, tenteront, tout en reconnaissant les limites de leurs géniteurs, d’accueillir ce qui leur est offert. Il est plus facile d’être dans la gratitude quand la relation parents-enfants est bonne. La meilleure façon de tenter d’acquitter cette dette de vie, inextinguible (dont on ne peut pas s’acquitter) forcément, est de donner la vie à son tour, ou bien d’être créateur de sa propre vie. Freud cite Goethe qui exhorte les fils, les enfants à s’approprier l’héritage symbolique des ancêtres : hériter passivement est une chose, vouloir cet héritage, le transformer permet de prendre en compte cette dette de vie sans s’écrouler sous son poids. »
Explication et commentaire.
Dans cette interview, Jacques Arènes donne aux notions de gratitude et d’ingratitude une connotation « existentielle », c’est-à-dire qu’il les considère comme des façons de prendre notre existence avant de désigner des postures ou des sentiments que nous adresserions à des personnes. Avons-nous à remercier la vie de nous avoir fait don de notre existence, ou bien pouvons-nous, au contraire, haïr ce « diktat », pointer du doigt cet autoritarisme d’une vie qui nous met devant le « fait accompli » d’exister ? Nous percevons bien que quelque chose « cloche » dans ces deux attitudes. Notre venue au monde est « contingente », c’est-à-dire qu’elle n’est pas nécessaire, nous aurions tout aussi bien pu ne pas exister. Que je rendre grâce à la vie de ma vie ou que je lui en fasse reproche, je fais comme si quelque chose de moi n’était pas intégralement fait, produit, contenu dans le fait de mon existence. Reprocher à la vie de m’avoir donné la vie, c’est regretter d’être, mais d’où pourrait se situer la démarche même de ce reproche si ce n’est de cela même qui la rend possible, ou plutôt effective, en cet instant même, c’est-à-dire du fait que c’est bel et bien en tant qu’existant que je regrette d’exister ? Si je pense qu’il aurait été préférable pour moi de ne pas exister, je me réfère à un jugement sur la vie dont on ne voit pas bien d’où il pourrait être émis si ce n’est de l’existence même. Peut-être mon existence est-elle contingente mais il n’est rien de moi qui puisse prétexter cette contingence pour justifier une remise en cause ou un remerciement, parce qu’être moi, c’est exactement ce qui s’accomplit dans l’actualisation de cette contingence. Pour réaliser que mon existence est contingente, encore faut-il que mon existence « soit », et cela : ce n’est pas contingent. C’est dans l’émergence nécessaire de ma venue au monde que seule peut me venir à l’idée l’évidence de la contingence de mon existence.
Que l’on remercie ou que l’on fasse reproche à la vie de vivre, on se situe à son égard dans un décalage existentiel tout-à-fait paradoxal, voire improbable, mais il y a dans ce décalage quelque chose qui pourrait bien faire signe de toute l’ambiguité de la conception humaine du Droit.
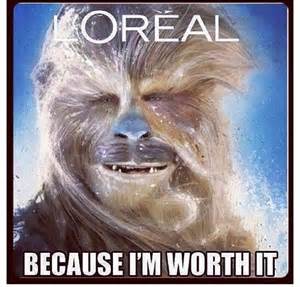 L’auteur se situe d’emblée du côté de la gratitude dans la mesure où elle induit la responsabilisation à l’égard de son existence. Si « je n’ai pas demandé à naître », alors tout m’est dû pour faire passer la pilule de la venue au monde. On se situe ainsi, en toute occasion, dans une attitude hyper-revendicative. Nous estimons que notre personne, notre statut nous donnent des droits, et ce, de « plein droit ». « Nous le valons bien ».
L’auteur se situe d’emblée du côté de la gratitude dans la mesure où elle induit la responsabilisation à l’égard de son existence. Si « je n’ai pas demandé à naître », alors tout m’est dû pour faire passer la pilule de la venue au monde. On se situe ainsi, en toute occasion, dans une attitude hyper-revendicative. Nous estimons que notre personne, notre statut nous donnent des droits, et ce, de « plein droit ». « Nous le valons bien ».
A cet instant, la tournure de l’interview devient franchement « sociale ». Nous comprenons que Jacques Arènes évoque cette attitude très répandue qui consiste à faire valoir continûment ses supposés droits, comme si la société nous devait tout. Le fait qu’il existe, en effet, des institutions, une administration chargée de gérer une population instaure en nous une multitude de principes et de présupposés parmi lesquels cette idée selon laquelle une autorité chargée de veiller à ce que chaque membre de la communauté ne soit pas lésé existe « quelque part ». Cette autorité est l’Etat, lequel, dés lors est considéré comme responsable de chaque injustice. Mais jusqu’à quel point ? Est-ce à l’Etat de veiller à ce que tous ses administrés soient heureux ?
Jusqu’à quel point le fait que nous existions peut-il être pris en charge par des « organismes » de gestion, par une administration, par un état ? Nous réalisons que l’efficience physique de notre venue au monde est doublée par le présupposé d’une reconnaissance juridique et sociale qui, en un sens, en falsifie « la donne », en diminue l’impact, en dénature la réalité. Nous sommes socialement conditionnés à réclamer continuellement de la vie qu’elle nous apporte plus que ce qu’elle nous a structurellement, inconditionnellement donné, à savoir elle-même. Il n’est pas exclu que le bonheur consiste à revenir à cette dimension primitive, « natale » dont nous pourrions saisir, en en prenant conscience (ce qui supposerait un effort extrêmement exigeant pour la plupart de nos contemporains) qu’elle nous a été donnée sans exigence de retour (remerciement) et sans possibilité de recours (regret). Il existe une neutralité de position à l’égard de l’existence qui s’impose de la nature même de son évènementialité, laquelle est « donnée ».
Jacques Arènes ne se situe pas dans cette perspective philosophique mais il relève très justement à quel point notre perception est devenue tellement et exclusivement « sociale » que l’attitude qui consiste à se satisfaire de son sort est considérée par la plupart des gens comme une marque de faiblesse et de bêtise, voire d’inconscience. Si nous omettions de réclamer ce qui nous serait « dû », nous adopterions une posture servile, absurde, méprisable. Finalement être heureux au sens de naïf, de non revendicatif, de satisfait de son sort, c’est devenu synonyme d’être imbécile. Contre cette mentalité, le psychanalyste évoque les bienfaits de ce fond de gratitude élémentaire, principiel à l’égard d’une vie qui n’est que donnée.
Freud a compté parmi ses patients un névrotique souffrant de cette obsession de la dette : celle de son père. C’est comme s’s’il s’agissait pour lui de s’acquitter de la dette d’existence qu’il pensait devoir à son père en réglant les dettes d’argent laissées par ce dernier. Il faut savoir que cette névrose a probablement causé la mort de ce patient qui, engagé dans l’armée durant la guerre, se serait laissé mourir au combat selon de nombreux témoins. Au-delà du cas particulier de « l‘homme aux rats », cette approche psychanalytique du rapport à nos géniteurs pose une très bonne question : n’existe-t-il pas un fond de névrose consubstantiel à toute existence humaine ? Dans quelle mesure pouvons-nous aborder notre existence dans d’autres termes que ceux de la culpabilité, de la dette, de l’insolvabilité structurelle de notre compte (non plus courant mais « vivant »). Ce passage est à aborder en parallèle avec la perspective judéo-chrétienne de la faute, de l’existence substantiellement coupable de l’humanité (la faute d’Adam et Eve).
Ce poids écrasant de la dette dans la réalisation de notre venue au monde nous interdirait précisément la neutralité : soit nous vivrions dans son déni violent, ce qui impliquerait le désir forcené de rater sa vie pour en faire reproche à ses parents, soit la relation aux parents sera marquée par une obéissance et un respect absolus, voire une frome d’adoration ou de complexé d’infériorité tout-à-fait dommageable.
Mais Jacques Arènes n’envisage pas ici cette perspective, précisément parce qu’il reste dans le sillage de la direction tracée dès le départ, celui d’une gratitude pure, impersonnelle, vouée exclusivement à la vie en tant que telle : la joie d’être vivant. Peut-être avons-nous moins à rendre ce qui nous a été donné qu’à donner dans la continuité du don de vie qui nous a été fait. Donner la vie, ce serait alors situer sa vie à la hauteur de la vie même : le don total, sans attente ni espoir de remboursement. Nous pouvons nous enferrer dans le cercle vicieux d’une dette infinie et d’une existence structurellement insolvable ou bien convertir ce crédit dont nous ne pourrons jamais nous acquitter en énergie pleine, positive, comme si l’impossibilité même de remboursement d’une dette aussi « native », principielle, loin de marquer un dû dont nous ne pourrions nous dégager faisait signe d’une absolue gratuité, d’une impossible comptabilité de tout donné existentiel. Dans cette perspective, le bonheur pourrait se concevoir comme cet échappement de l’existence à l’égard de toutes les tentatives de sa réduction à des processus de comptabilité bancaire. Je n’ai pas davantage droit au bonheur que je n’ai le droit d’exister, tout simplement parce que le bonheur consiste à saisir l’existence dans tout ce qu’elle suppose de primitivement indu, d’offert, d’heureuse fatalité. Cette perspective présente ainsi l’avantage de rendre parfaitement compte de l’étymologie du terme « bonheur » (chance, présage, bon augure)






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire